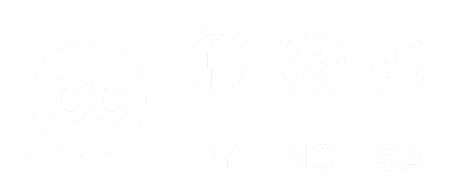Enregistrer en studio
Enregistrer en studio
Comment se déroule une session en studio professionnel ? Faut-il privilégier le re-re ou le live ?
MISE EN PLACE
PLACEMENT EN STUDIO
Avec le producteur, la productrice et l'ingénieur.e du son il faut avant tout déterminer la place de chacun.e en prenant en compte l'acoustique, la communication entre tous, la méthodologie d'enregistrement choisie (live ou re-re), le confort, l'espace disponible, les possibilités de câblage et le positionnement des micros -- qui jouera grandement sur la repisse (ou diaphonie : lorsqu'un micro dédié à un instrument capte des sons d'autres sources).
Une fois tout le monde installé (musicien.ne.s, instruments et assimilés, microphones), il faudra absolument s'accorder parfaitement, et balancer pour que l'ingénieur du son prépare la session en réglant les gains (ajustement du volume de chaque source), et les effets dynamiques.
Il faut s'assurer que le son est bon 'à la source' pour garantir un enregistrement exploitable au maximum, tout en y appliquant le moins d'effets possible afin de garder un signal source laissant des possibilités optimales de mixage.
Enfin, il faut se familiariser avec son retour, la plupart du temps un casque dont le volume de chaque piste enregistrée est spécifiquement réglable pour chaque participant.e.
Avec le producteur, la productrice et l'ingénieur.e du son il faut avant tout déterminer la place de chacun.e en prenant en compte l'acoustique, la communication entre tous, la méthodologie d'enregistrement choisie (live ou re-re), le confort, l'espace disponible, les possibilités de câblage et le positionnement des micros -- qui jouera grandement sur la repisse (ou diaphonie : lorsqu'un micro dédié à un instrument capte des sons d'autres sources).
Une fois tout le monde installé (musicien.ne.s, instruments et assimilés, microphones), il faudra absolument s'accorder parfaitement, et balancer pour que l'ingénieur du son prépare la session en réglant les gains (ajustement du volume de chaque source), et les effets dynamiques.
Il faut s'assurer que le son est bon 'à la source' pour garantir un enregistrement exploitable au maximum, tout en y appliquant le moins d'effets possible afin de garder un signal source laissant des possibilités optimales de mixage.
Enfin, il faut se familiariser avec son retour, la plupart du temps un casque dont le volume de chaque piste enregistrée est spécifiquement réglable pour chaque participant.e.
MéTHODOLOGIES D'ENREGISTREMENT
RE-RE, BACKTRACK, DROPS, ET AUTRES PUNCH-IN
Après une phase de balance (réglages de niveaux et d'effets, tests en changements de micro, etc) et d'accordage, l'enregistrement pourra démarrer. Il exige plusieurs approches pour ce faire mais généralement on se base sur une première prise étalon, maquette, piste 'guide' ou backtrack.
Métronome
L’enregistrement au clic est souvent systématique : un métronome audible seulement dans les retours (casques) permettra de caler tout le monde ensemble et de revenir sur chaque mesure si nécessaire, tout en facilitant l’édition des parties rythmiques.
Re-re
Souvent enregistrée live, ou préparée par le groupe en amont du studio sous la forme d'une maquette, la backtrack sert de témoin de base pour enregistrer chaque parfaitement instrument tour à tour de manière particulièrement précise. C'est en écoutant cette piste témoin et en jouant avec que l'on ré-enregistre chaque partie en re-re.
Live
Certains projets en reste à des prises live qui captent tous les instrumentistes ensemble et en direct, préférant l'énergie naturelle d'un jeu en groupe à la précision moins spontanée d'un re-re méticuleux.
Overdubs et double
C'est souvent une hybridation de méthodes qui est privilégiée en studio : enregistrement live, édition, puis re-re des pistes importantes (chant, solo, etc) et autres arrangements (on parle alors d'overdubs : le rajout de nouvelles pistes pour densifier et agrémenter la base principale).
Il est aussi courant de doubler certaines prises, notamment les guitares ou les voix, afin de créer certains effets stéréo ou de donner plus de corps à ces parties.
Punch-in et drop
On peut aussi rajouter ou corriger un bref passage d'une version presque parfaite de telle ou telle piste : ainsi le punch-in permet d'enclencher l'enregistrement sur les quelques mesures à revoir.
Enfin, il est aussi possible corriger certaines gaffes à la main en éditant la piste depuis un logiciel.
Métronome
L’enregistrement au clic est souvent systématique : un métronome audible seulement dans les retours (casques) permettra de caler tout le monde ensemble et de revenir sur chaque mesure si nécessaire, tout en facilitant l’édition des parties rythmiques.
Re-re
Souvent enregistrée live, ou préparée par le groupe en amont du studio sous la forme d'une maquette, la backtrack sert de témoin de base pour enregistrer chaque parfaitement instrument tour à tour de manière particulièrement précise. C'est en écoutant cette piste témoin et en jouant avec que l'on ré-enregistre chaque partie en re-re.
Live
Certains projets en reste à des prises live qui captent tous les instrumentistes ensemble et en direct, préférant l'énergie naturelle d'un jeu en groupe à la précision moins spontanée d'un re-re méticuleux.
Overdubs et double
C'est souvent une hybridation de méthodes qui est privilégiée en studio : enregistrement live, édition, puis re-re des pistes importantes (chant, solo, etc) et autres arrangements (on parle alors d'overdubs : le rajout de nouvelles pistes pour densifier et agrémenter la base principale).
Il est aussi courant de doubler certaines prises, notamment les guitares ou les voix, afin de créer certains effets stéréo ou de donner plus de corps à ces parties.
Punch-in et drop
On peut aussi rajouter ou corriger un bref passage d'une version presque parfaite de telle ou telle piste : ainsi le punch-in permet d'enclencher l'enregistrement sur les quelques mesures à revoir.
Enfin, il est aussi possible corriger certaines gaffes à la main en éditant la piste depuis un logiciel.
EDITION
COUPER COLLER
Une fois la prise principale retenue, l'ingénieur.e du son va éditer chaque piste en corrigeant au sein de son logiciel les petites erreurs : coups de caisse-claire manquant, basse qui tombe à côté du temps, cafouillage sur la fin du solo... Il est parfois plus rapide et tout aussi efficace de copier coller un autre bout de l'enregistrement pour optimiser le résultat plutôt que de s'atteler à un drop (ou punch in) afin de ré-enregistrer LA mauvaise note du morceau.
A l'heure des super-calculs informatiques des plugins permettent de remplacer automatiquement l'ensemble d'une prise de batterie par des enregistrements parfaits de chaque élément de celle ci : une pratique très courante pour obtenir le son voulu de manière efficace sans passer des heures en placement de micro et accordages de fûts.
Il est aussi crucial de jauger à quel point corriger une piste : les imperfections et défauts sont parfois le reflet d'une dynamique particulière, d'une énergie qui transparait et qui peut servir le titre. En gommant et lissant tout le morceau on peut vite se retrouver à effacer la patte des musicien.ne.s et à perdre toute sensibilité.
Une fois les derniers re-re effectués et l'édition réalisée, l'ingénieur du son peaufine un premix avec le groupe au sein du studio, qui sert de base pour le travail de mixage de cette session d'enregistrement.
Pour aller plus loin
A l'heure des super-calculs informatiques des plugins permettent de remplacer automatiquement l'ensemble d'une prise de batterie par des enregistrements parfaits de chaque élément de celle ci : une pratique très courante pour obtenir le son voulu de manière efficace sans passer des heures en placement de micro et accordages de fûts.
Il est aussi crucial de jauger à quel point corriger une piste : les imperfections et défauts sont parfois le reflet d'une dynamique particulière, d'une énergie qui transparait et qui peut servir le titre. En gommant et lissant tout le morceau on peut vite se retrouver à effacer la patte des musicien.ne.s et à perdre toute sensibilité.
Une fois les derniers re-re effectués et l'édition réalisée, l'ingénieur du son peaufine un premix avec le groupe au sein du studio, qui sert de base pour le travail de mixage de cette session d'enregistrement.
|
editionsladecouverte.fr Hits, enquête sur la fabrique des tubes (John Seabrook) |
TRAVAILLER AVEC UN.E « PRODUCER »
LE RéALISATEUR ARTISTIQUE EN STUDIO
Le ou la « producer » souvent traduit par producteur/productrice mais correspondant en réalité au réalisateur ou à la réalisatrice artistique en France, peut booster l'enregistrement et le mix d'un projet en lui faisant profiter de son expérience, de son recul, de sa vision artistique, et de son savoir-faire technique.
Pour aller plus loin
Expliqué en vidéo
Ressources associées
TAKE ONE, LES PRODUCTEURS DU ROCK
Nicolas Dupuy (2012)
EN STUDIO AVEC LES BEATLES
Geoff Emerick (2014)
|
castorastral.com Take One, les producteurs du rock (Nicolas Dupuy) |
COMBIEN çA COûTE
LE PRIX DU STUDIO PRO
Se payer dune session en studio d'enregistrement professionnel a un coût qui varie en fonction du personnel mis à disposition, de la surface et du matériel mis à disposition... bref une étude de marché s'impose selon le type de studio recherché : en fonction du nombre d'artistes présents, de la renommée et du positionnement de tel ou tel studio, dédié à tel ou tel style de musique il faut s(attendre à des prix très variables selon les offres, qui dépendent aussi de la demande et donc de la zone géographique concernée !